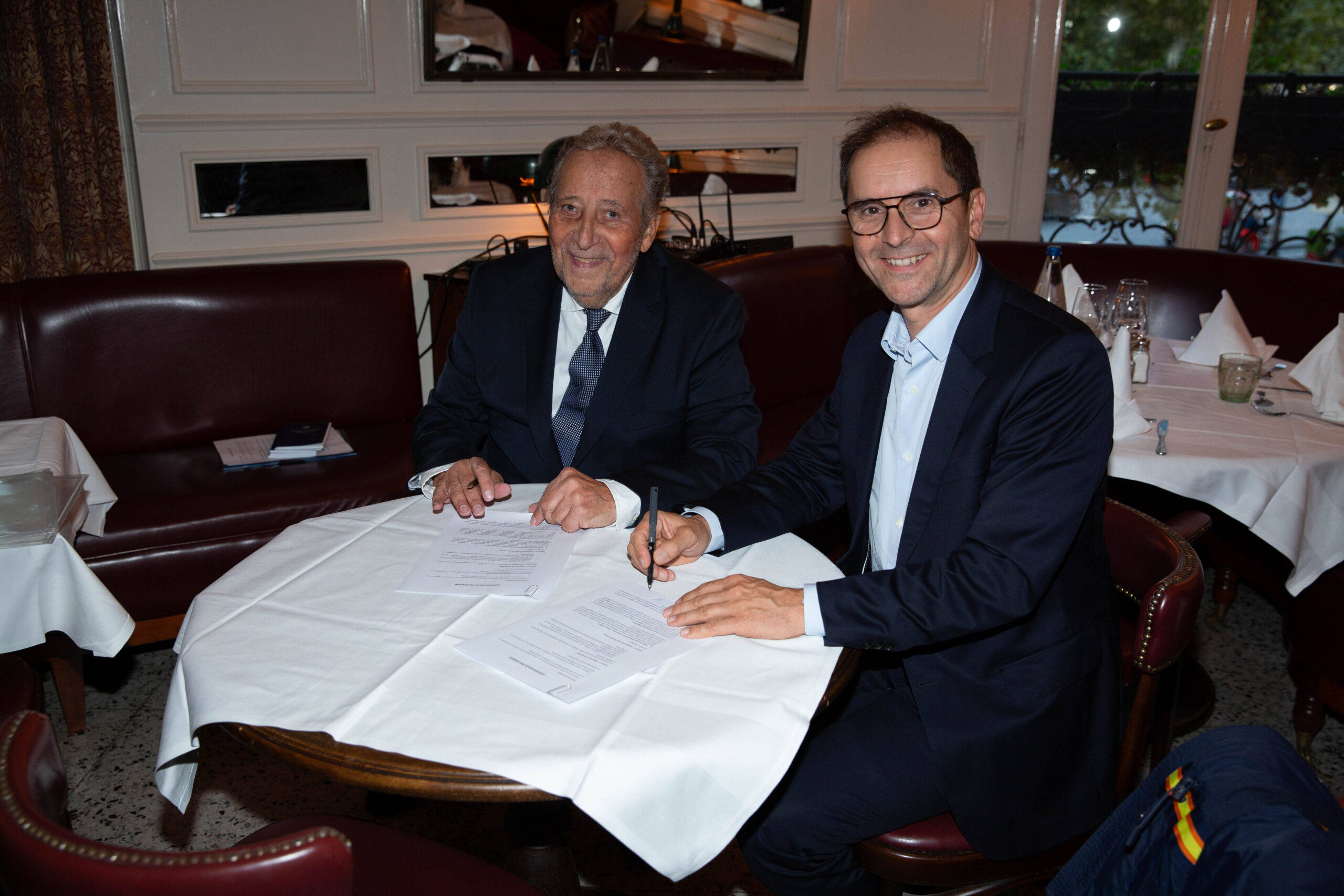Les valeurs locatives cadastrales, constituant la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, reposent encore pour les logements sur une évaluation générale réalisée en 1970 et entrée en vigueur en 1974.
Ces valeurs locatives sont présentées comme obsolètes, et les gouvernements successifs veulent une réforme pour remplacer les valeurs de 1970 par les valeurs réelles de 2026 (car la réforme va s’appliquer en 2026).
Plusieurs réformes ont été envisagées pour corriger cette base : la loi du 30 juillet 1990 a posé le principe d’une révision, sans mise en œuvre effective ; la loi de finances pour 2017 a tenté une expérimentation, elle-même reportée ; enfin, la loi de finances pour 2020 a fixé une entrée en vigueur en 2026, avec une première application prévue en 2027. Ce calendrier est aujourd’hui repoussé à 2028.
Au terme de ce calendrier, les valeurs locatives vont doubler.
La réforme de 2017 sur les locaux commerciaux
La révision de la valeur locative des locaux commerciaux, appliquée à partir de 2017, a eu des conséquences lourdes pour de nombreux commerçants. En actualisant les valeurs sur la base des loyers de marché, la réforme a entraîné une forte hausse de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une large part des établissements, notamment dans les zones urbaines attractives. Cette augmentation subite des charges a fragilisé les petites structures, déjà confrontées à des coûts d’exploitation élevés. Dans certains cas, la hausse fiscale a même menacé la rentabilité de commerces de proximité, accélérant la désertification commerciale de certains centres-villes. Si l’objectif affiché était une meilleure équité entre contribuables, les effets économiques immédiats ont souvent été ressentis comme un déséquilibre supplémentaire pour les acteurs les plus vulnérables du tissu local.
Une bombe fiscale
La révision des valeurs locatives vise à restaurer « l’équité » du système fiscal local en alignant les bases d’imposition sur la réalité économique des biens. Mais c’est une vraie bombe fiscale. Il s’agit essentiellement de renflouer les caisses des collectivités locales en légitimant cette réforme sous le couvert de « modernisme ». Cette actualisation provoquera une augmentation sensible des montants de taxe foncière pour de nombreux propriétaires, en particulier dans les zones urbaines où la valeur du foncier a fortement progressé depuis les années 1970.
L’expérience menée en 2017 pour les locaux professionnels a montré que les nouvelles évaluations pouvaient tripler les bases locatives. Pour éviter un choc fiscal, des mécanismes de « lissage » ont été instaurés sur dix ans, étalant la hausse progressive de la charge fiscale.
Les perspectives de la réforme à venir
La réforme des locaux d’habitation représente un chantier administratif considérable : plus de 46 millions de biens devront être réévalués. Son report périodique témoigne des difficultés techniques et politiques qu’elle soulève.
Pistes de réforme et recommandations
Afin de garantir la légitimité et la soutenabilité de la réforme, plusieurs orientations pourraient être envisagées :
- Transparence et concertation renforcées : impliquer davantage les collectivités locales, associations de propriétaires et experts fiscaux dans la définition des grilles de valeur locative.
- Progressivité et plafonnement : maintenir des mécanismes de lissage, mais assortis de plafonds modulés selon la situation économique des ménages et la typologie du logement.
- Actualisation périodique automatisée : inscrire dans la loi un dispositif d’actualisation régulière (par exemple tous les cinq ans) fondé sur des indicateurs objectifs de marché immobilier, afin d’éviter des révisions massives et tardives.
- Accompagnement social et territorial : prévoir des mesures transitoires de compensation pour les ménages modestes ou les communes les plus touchées par les hausses de bases.
- Interopérabilité des données foncières : exploiter les bases cadastrales, les observatoires des loyers et les données notariales afin d’assurer une évaluation uniforme, équitable et fiable.
Pour une meilleure équité de la taxe foncière
Depuis la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, la fiscalité locale a connu de profonds bouleversements. Cet impôt, longtemps perçu comme un moyen de participation des occupants aux finances locales, ne pèse plus aujourd’hui sur les locataires.
Ce changement entraîne un déplacement de la charge fiscale locale vers les propriétaires-bailleurs. La taxe foncière, supportée exclusivement par les bailleurs, connaît une hausse dans de nombreuses communes. Cette évolution pose la question de l’équilibre entre les coûts assumés par les propriétaires et ceux supportés par les locataires.
Dans ce contexte, une réflexion émerge sur la nécessité d’un partage plus équitable de la charge foncière. Si le locataire bénéficie directement des services publics locaux (voirie, éclairage, sécurité, etc.), il est légitime de s’interroger sur un mécanisme de répartition partielle ou indirecte de ces coûts, par exemple via les charges locatives ou une modulation des loyers. L’enjeu est de préserver un équilibre économique entre les droits et les contributions de chacun.
La révision des valeurs locatives constitue l’un des chantiers les plus déterminants de la décennie pour la fiscalité locale française. Toute augmentation de l’assiette d’imposition est inacceptable sans une diminution des taux d’imposition. La réussite d’une refonte de la taxe foncière dépendra de sa lisibilité, de sa progressivité, de sa capacité à restaurer la confiance entre l’administration et les contribuables et d’un rééquilibre de la charge entre le bailleur et le locataire.