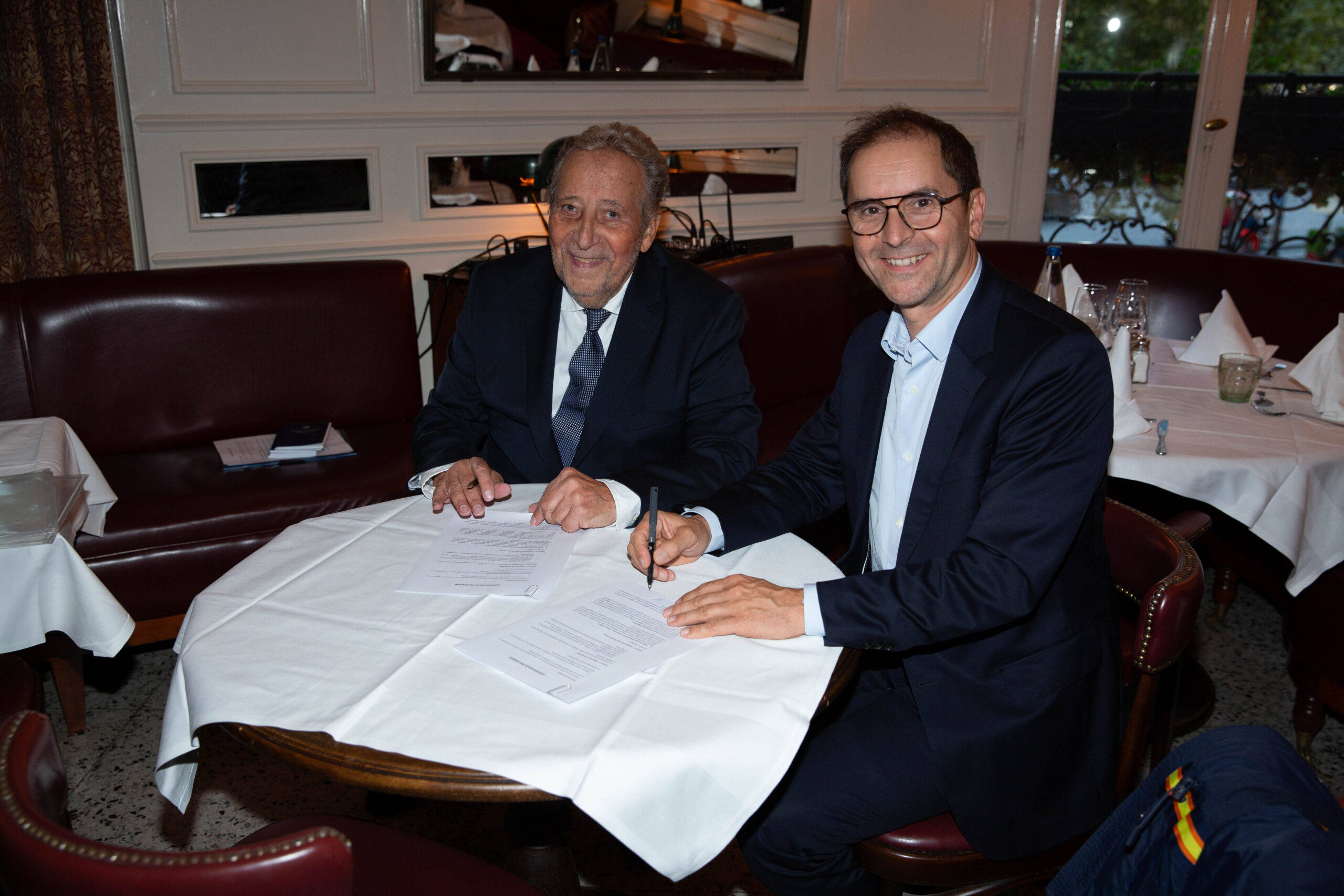Aux origines : du blocage des loyers à l’encadrement strict
La première étape remonte à 2012 avec le blocage des loyers à la relocation, qui limitait les hausses abusives lors d’un changement de locataire. Deux ans plus tard, la loi ALUR allait plus loin en instaurant un système de loyers de référence, fixés par quartier et type de logement.
En 2018, la loi ELAN relance ce dispositif à titre expérimental dans les villes volontaires (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux…).
Propriétaires et locataires se retrouvent donc dans un système unique en Europe : un double encadrement (blocage + plafonnement) qui rigidifie fortement le marché.
Regard international : la France parmi les plus strictes
Les modèles d’encadrement diffèrent largement dans le monde :
– Aux États-Unis et au Canada : les loyers sont libres à l’entrée, puis les hausses sont limitées.
– En Allemagne : les loyers sont encadrés à la relocation (+10 % max. du loyer médian).
– Aux Pays-Bas : un barème de points est instauré selon les caractéristiques du logement.
– En Suède : les loyers sont négociés collectivement.
Comparée à ces dispositifs, la France se distingue par une approche bien plus ferme, laissant peu de marge de manœuvre aux bailleurs.
Quels effets observés ?
1. Sur les prix
L’encadrement a eu un effet modérateur. À Paris par exemple, les loyers stagnent depuis 2015. Mais l’impact reste limité : dans les villes non encadrées (Rennes, Nantes…), la hausse des loyers a été plus marquée.
2. Sur l’offre locative
C’est l’effet le plus contesté. Entre 2021 et 2024, les grandes villes encadrées ont perdu en moyenne 40 % de leur parc locatif disponible, soit encore plus que la moyenne nationale. De nombreux propriétaires préfèrent basculer vers la location meublée touristique ou retirent leurs biens du marché.
3. Sur l’équité sociale
Si certains locataires bénéficient de loyers modérés, l’accès au logement devient paradoxalement plus difficile pour les nouveaux entrants (jeunes, étudiants, familles modestes). Une sélection accrue des dossiers rend le marché plus inégalitaire.
Le dilemme français : réguler, ou libérer ?
Si le dispositif protège une partie des ménages, il entraîne aussi des effets pervers : découragement de l’investissement, raréfaction de l’offre et tensions accrues dans les zones tendues.
La France se retrouve face à une contradiction : l’encadrement limite la flambée des loyers, mais il ne résout pas le problème fondamental : la pénurie de logements.
À l’étranger, les modèles plus souples (Suède, Pays-Bas) semblent mieux concilier stabilité des loyers et préservation de l’offre.
L’encadrement des loyers en France illustre un choix politique fort : celui de réguler un marché jugé trop déséquilibré. Mais ce choix a un coût : une rigidité inédite qui, à long terme, risque de fragiliser encore l’offre locative.
La vraie réponse pour stimuler l’offre locative réside dans la création pour le neuf et l’ancien de deux statuts :
- Celui du loyer libre (sans contrainte mais sans avantage particulier) ;
- Celui du loyer encadré (inférieur à la moyenne réelle des loyers libres, mais avec un avantage fiscal attractif).